Kolkhoze par Emmanuel Carrère
Ce livre d’Emmanuel Carrère, roman familial, mille fois recensé, loué, simplement magnifique
Enfants, nous le sommes. Fils ou fille, on le devient, à l’arrache, personne ni aucun manuel ne me l’a appris, ou alors j’ai oublié ; j’ai fait comme tant d’autres, j’ai appris en solo, mal sans doute, et longtemps ce ne fut pas une question ; ma mère, puis mon père six mois plus tard ont rejoint le même carré de terre au cimetière du village, mon père sans que je me réconcilie avec lui après une dispute. Près de cinquante ans plus tard, au bout de ma vie donc, je me demande quel fils j’ai pu être, pourquoi mon père et moi ne pouvions nous supporter plus de quatre jours sans nous quereller. J’ai lu avec bonheur ce livre d’Emmanuel Carrère, roman familial, mille fois recensé, loué, simplement magnifique.
Trois ans de guerre et cent ans de vie familiale
Au départ de ce livre il y a deux séismes qui s’entrecroisent, le premier avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et l’autre qui est la mort de ses deux parents à quelques mois d’intervalle, à l’âge de quatre-vingt-quatorze et quatre-vingt-quinze ans. Trois ans de guerre et cent ans de vie familiale. La mort de sa mère, Hélène, est « une de ces morts qui donnent l’impression de couronner une vie. Comme si tout prenait alors une espèce de grandeur. Et tout ce qui concernait la Russie a refait surface d’une façon cette fois, très intime. » Son père, Louis, passionné de généalogie, lui laisse un matériau extraordinairement documenté sur l’histoire de sa famille. Dans ce livre foisonnant, il y a bien des allers-retours et on peut se perdre au début, se demander qui parle avec qui, ce n’est pas grave, la chronologie est respectée, de petits sommaires font étape.
Sa mère, Hélène Carrère d’Encausse
Hélène Carrère d’Encausse, fille d’immigrés pauvres, de père géorgien et de mère russe, porteuse de tout ce que la Russie peut avoir de grandiose et de féroce. Elle est à elle seule un personnage de roman, brillante, historienne de la Russie, secrétaire perpétuelle de l’Académie française. Le fils n’oublie pas ses zones d’ombre ; elle pouvait être coriace, impitoyable, d’une mauvaise foi presque drôle, « capable de mentir quand on lui demandait l’heure ». Elle avait seize ans lorsque son père disparaît à la Libération : mal intégré dans son pays d’accueil, il était devenu collabo. Elle s’est construite dans le refus de cette histoire familiale.
Son père, Louis Carrère
Louis vient de la région bordelaise, cadre dans une société d’Assurances, discret ; à la fin de sa vie, « il habitait au fond du couloir », plongé dans son arbre généalogique. Héritant de ce travail colossal, Emmanuel Carrère le sort de l’ombre avec beaucoup de tendresse. Son épouse pouvait le rudoyer parfois, lui ne se serait jamais séparé d’elle, même si, le temps d’une confidence, il a pu lâcher qu’il avait fait le plus gros. Soixante-douze ans de vie commune tout de même ; on peut sans crainte imaginer qu’ils ont dû l’un et l’autre y trouver leur compte. Pour l’auteur du livre, « c’est lui qui a aimé le plus, dans cette affaire. Il y a deux vers de W.H. Auden que je trouve très beaux : Si l’amour doit être inégal, qu’il me soit donné d’être celui qui aime. »
Lorsqu’il devait partir en province pour son travail, ses trois jeunes enfants avaient le droit de venir dormir dans la chambre de leur maman, c’est là qu’ils jouaient à « faire Kolkhoze ». « À la source, il y a eu cet amour qui nous a unis dans notre enfance. »
Pourrai-je dire comme Emmanuel Carrère que j’ai eu une enfance heureuse ?
Je suis heureux du chemin qui fut le mien : à l’image des saisons, il y eut des temps de froidure et de germination, mais je ne les ai jamais attribués à mon enfance avec mes parents, alors que c’est par là que je suis devenu leur fils.
Gérard Marle fc

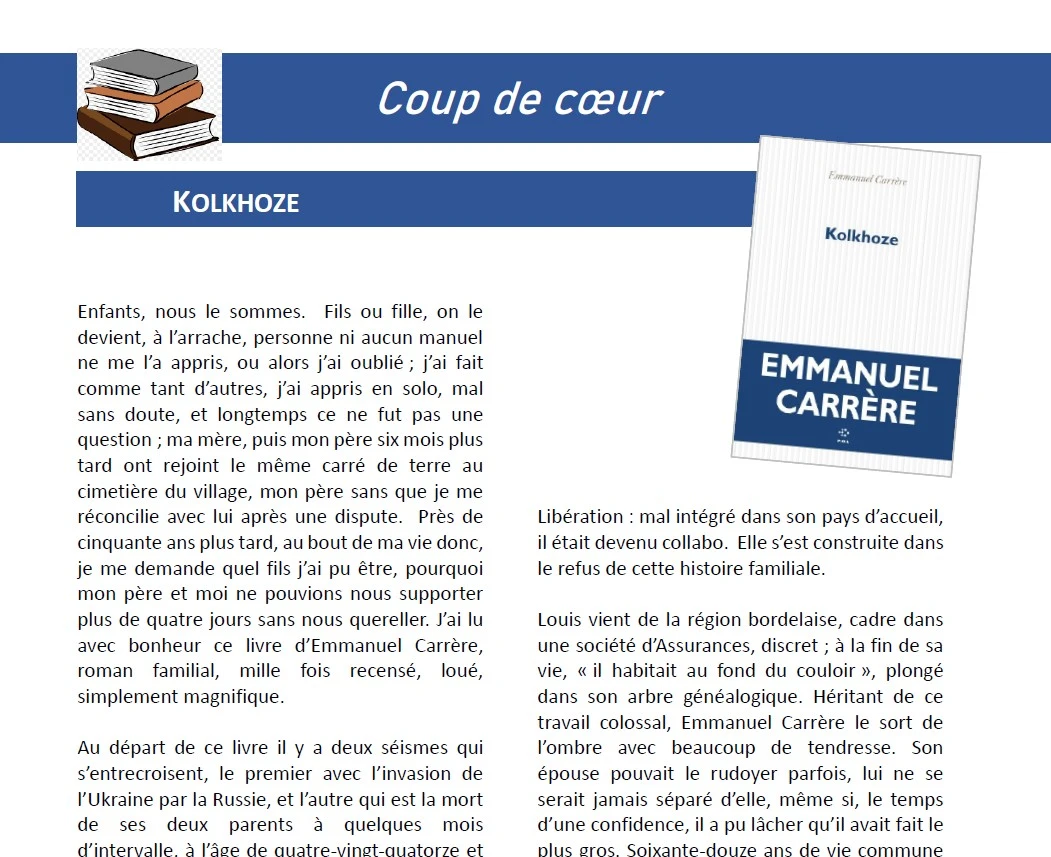

0 commentaires